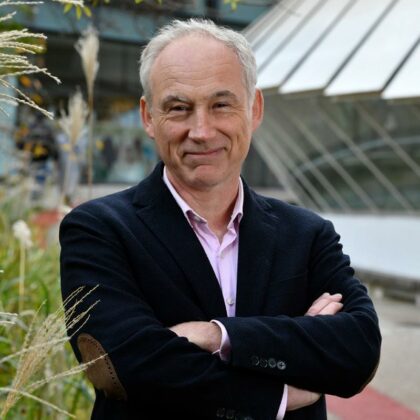Entretien conduit par Bernard Müller pour Togo Cultures, Février 2025
À l’occasion de sa prise de fonction en octobre 2023 comme directeur de la recherche et de l’enseignement au musée du quai Branly – Jacques Chirac, Benoît de L’Estoile revient sur son parcours d’anthropologue et sur les tensions persistantes entre esthétique muséale, héritages coloniaux et production de savoirs. « Le musée peut produire de l’allochronie – cette mise à distance temporelle qui déshistoricise les objets. Il faut au contraire les réinscrire dans des relations, souvent conflictuelles, de circulation, d’usage, d’appropriation. »
La notion d’allochronie est mobilisée de manière critique pour désigner l’effet muséographique par lequel des objets sont extraits de leur historicité et présentés dans un temps figé, souvent celui de « l’autre culturel » — une idée directement inspirée des travaux de Johannes Fabian. Dans son ouvrage Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object (1983), dans lequel il critique la manière dont l’anthropologie occidentale a historiquement relégué ses objets d’étude — les sociétés dites « traditionnelles », celles précisément dans lesquelles sont catégorisées une bonne partie des collections du musée — dans un autre temps, les privant ainsi de co-temporalité avec l’observateur occidental. Fabian appelle ce processus l’allochronie, soit le fait de situer l’autre dans un temps autre, en dehors du présent partagé. Quant à la notion de relation régulièrement pourrait faire référence à l’un des concepts centraux de la pensée d’Édouard Glissant, poète, philosophe et théoricien martiniquais. Elle est au cœur de sa réflexion sur l’identité, la mondialisation, la créolisation et les dynamiques culturelles postcoloniales. Pour Glissant, la Relation désigne une manière d’être-au-monde interconnectée, ouverte et mutuelle. Elle s’oppose à une conception figée, unitaire et exclusive de l’identité. La Relation est ce qui relie les êtres, les cultures, les langues dans un mouvement constant d’échange et de transformation réciproque.
« Le défi, c’est de créer des ponts entre les temporalités de la recherche et celles de l’exposition. Cela passe par de nouveaux formats, des parcours sonores, des séminaires ouverts, mais aussi par des partenariats durables avec les communautés d’origine. »
Qu’il s’agisse des musées autochtones au Brésil ou de projets de recherche collaborative au Mali ou au Bénin, l’entretien explore les modalités concrètes d’un musée réflexif, qui assume ses contradictions et cherche à en faire matière à débat et à transmission. « Il ne suffit pas de restituer pour résoudre. Il faut apprendre à dialoguer, à transformer le musée en espace de pensée partagée. »
Il revient notamment sur l’expédition Dakar-Djibouti (1931–1933), menée par Marcel Griaule et considérée comme un acte fondateur de l’ethnologie française, une exposition en cours au musée du quai Branly – Jacques Chirac. En évoquant cette mission dans l’entretien, il souligne à quel point elle cristallise les tensions entre production scientifique, entreprise coloniale et collecte patrimoniale. Le musée du quai Branly, en tant qu’héritier indirect de cette histoire, se trouve confronté à ses ambivalences : d’un côté, il revendique une rupture avec l’approche coloniale du musée de l’Homme ; de l’autre, il reste tributaire d’un héritage institutionnel façonné par des logiques d’appropriation et d’esthétisation.
De l’anthropologue au directeur de la recherche au musée du quai Branly
Bernard Müller : Tu es avant tout un anthropologue, inscrit dans une posture de recherche. Ton travail s’inscrit dans une ethnographie du monde muséal, dans une approche à la fois épistémologique et historique. En quoi ton passage, de chercheur observateur à directeur de la recherche et de l’enseignement au musée du quai Branly, t’amène-t-il à reformuler la question : à quoi sert ce musée ?

Benoît de L’Estoile: Il faut peut-être commencer par rappeler mon parcours. Ma thèse portait sur l’histoire de l’anthropologie coloniale dans l’Afrique britannique, en particulier sur le lien entre la révolution scientifique impulsée par Malinowski et la transformation des modes de gouvernement coloniaux dans l’entre-deux-guerres. C’était une recherche à la fois historique et comparative. J’ai aussi étudié comment, en France, à la même époque, l’ethnologie s’est structurée autour d’enjeux d’exposition, notamment avec l’Exposition coloniale de 1931 et la mission Dakar-Djibouti, considérée comme un acte fondateur. Quand le projet du musée du quai Branly a émergé, il s’agissait de créer un musée des « arts premiers » en rupture avec le musée de l’Homme, renvoyé à un passé colonial et à un modèle naturaliste. Le musée du quai Branly voulait valoriser les œuvres en tant qu’objets esthétiques. C’est dans ce contexte que j’ai écrit Le Goût des autres, une anthropologie des musées et des choix muséographiques français, dans une perspective comparée avec d’autres pays.
B.M.: Justement, dans Le Goût des autres, tu évoques la nécessité de passer d’un « musée des autres » à un « musée de la relation ». Peux-tu préciser cette idée, et comment elle influence aujourd’hui ton rôle au sein du musée ?
Benoît de L’Estoile: Le musée du quai Branly se concentre sur les arts de l’Afrique, des Amériques, de l’Asie et de l’Océanie – à l’exclusion de l’Europe. Ce choix soulève une question essentielle : est-ce vraiment un musée des autres ou bien un musée du soi, dans la mesure où l’Europe est omniprésente dans la relation coloniale ? Il ne s’agit plus de présenter des cultures figées, mais de montrer comment les objets sont issus de relations, souvent violentes, de domination, d’échange, de circulation. C’est là que le musée peut devenir un lieu de relation, de mise en récit de ces interactions, au lieu d’en gommer les traces. Raconter l’histoire d’un objet, ses usages, son parcours jusqu’au musée, c’est aussi créer un lien avec le visiteur. C’est une forme de réflexivité qui devrait irriguer toutes les dimensions du musée.
Temporalité, allochronie et muséographie
B.M. : Tu as souvent évoqué le concept d’allochronie. Le musée, tel qu’il est conçu, contribue-t-il à figer les objets dans un autre temps, à les extraire de leur historicité ?
Benoît de L’Estoile: Oui, c’est un enjeu central. Le musée peut produire de l’allochronie, c’est-à-dire cette mise à distance temporelle qui déshistoricise les objets. On les transforme en objets de pure contemplation esthétique, en oubliant les contextes dans lesquels ils ont été produits, utilisés et collectés. Est-ce que la recherche, au sein du musée, peut contribuer à briser cette allochronie ? Je pense que oui. C’est même l’une de ses fonctions majeures. Mais il faut admettre qu’il y a une distance entre les temporalités de la recherche et celles de l’exposition. Les expositions permanentes, par leur inertie, figent les objets. La recherche peut alimenter des expositions temporaires, des dispositifs spécifiques, mais il faut créer des passerelles pour que cela se traduise dans l’espace muséal.
Une recherche intégrée à la programmation du musée
B.M.: Concrètement, comment la recherche interagit-elle avec la programmation et la production au musée
Benoît de L’Estoile: Historiquement, c’était très cloisonné. Le musée s’est structuré avec un département du patrimoine et des collections, un département de la recherche, et un département du développement culturel. Mon rôle aujourd’hui est d’encourager les croisements entre ces sphères. Par exemple, nous incitons les chercheurs invités à animer des séminaires non seulement pour les doctorants mais aussi pour les agents du musée.
B.M.: Tu cherches à multiplier les formats intermédiaires, à créer des ponts.
Benoît de L’Estoile: Exactement. Nous avons des initiatives comme les ‘Têtes chercheuses’, où de jeunes chercheur·e·s présentent leurs travaux à partir d’images, suivies de discussions ouvertes. Nous avons aussi développé des parcours sonores, et nous travaillons à mieux intégrer les résultats des recherches dans les espaces d’exposition, y compris via des cartels enrichis.
Musées et identités : circulation, revendication, coopération
B.M. : Tu évoques souvent la pluralité des esthétiques et des usages du musée dans d’autres contextes, comme au Brésil.
Benoît de L’Estoile: Oui, j’ai observé comment des musées communautaires, notamment quilombolas ou autochtones, réutilisent la forme muséale pour revendiquer une histoire et des droits. Un petit musée dans un syndicat rural peut devenir un outil pour affirmer une identité, rappeler l’histoire de l’esclavage, revendiquer des terres. Le musée devient alors un instrument de lutte politique.
- M.: Et c’est aussi un enjeu pour les musées occidentaux : repenser leurs relations avec les communautés d’origine.
Benoît de L’Estoile: Absolument. Il faut construire des partenariats sur le long terme, dans une logique de coopération. C’est ce que nous faisons par exemple avec le musée de São Paulo autour des collections Lévi-Strauss, ou avec le musée national du Mali sur les objets Bamana. Ces projets internationaux permettent une relecture partagée des collections.
Conclusion : faire du musée un espace réflexif
B.M.: Aujourd’hui, les musées sont de plus en plus questionnés. Comment réaffirmer leur pertinence ?
Benoît de L’Estoile: Il ne suffit pas de restituer des objets pour clore le débat. Il faut inventer des formats, des récits, des coopérations qui permettent de faire vivre ces objets autrement. Le musée doit devenir un lieu d’échange, de réflexivité, et de transformation. La recherche y a toute sa place, mais elle doit se rendre accessible, lisible, et être traduite dans l’espace et les pratiques muséales.

A voir à Paris actuellement :
L’exposition « Mission Dakar-Djibouti (1931-1933) : Contre-enquêtes » se tient actuellement au musée du quai Branly – Jacques Chirac à Paris, du 15 avril au 7 septembre 2025. Elle propose une relecture critique de l’une des plus célèbres expéditions ethnographiques françaises du XXe siècle, dirigée par Marcel Griaule.
Une expédition au cœur du colonialisme
Entre 1931 et 1933, la mission Dakar-Djibouti a traversé 14 pays africains, collectant plus de 3 000 objets, 6 000 spécimens naturels, 300 manuscrits, environ 50 restes humains, 20 enregistrements sonores et plus de 10 000 notes de terrain . Ces collectes, souvent réalisées dans un contexte de domination coloniale, ont suscité des controverses, notamment celles relatées par Michel Leiris dans son ouvrage *L’Afrique fantôme*.
Une exposition critique et contemporaine
L’exposition met en lumière les méthodes de collecte de l’époque et questionne leur légitimité. Elle confronte archives, objets collectés et perspectives contemporaines, notamment africaines, pour interroger l’héritage colonial des collections muséales . Des documents, photographies et objets sont présentés pour illustrer ces enjeux.
* Benoît de l’Estoile, Le Goût des autres – de l’exposition coloniale aux arts premiers, Champs (n° 970) – Champs essais, 2010
Pour plus d’informations ou pour réserver votre visite, vous pouvez consulter la page officielle de l’exposition : https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/mission-dakar-djibouti-1931-1933-contre-enquetes